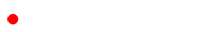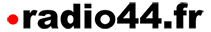L’Amant de Marguerite Duras, le récit de son enfance et de son adolescence en Indochine française, ce roman aux traits autobiographiques est l’essai d’une analyse de soi-même. Le récit est marqué par deux événements majeurs : la traversée du Mékong pour aller à Saïgon où se trouve l’école de la jeune fille ainsi que son séjour là-bas. Pendant son séjour en Indochine, elle tombe amoureuse d’un riche Chinois et vit son premier amour. Une lecture captivante de Kristine Maerel.
L’Amant
Marguerite Duras
Extraits
L’histoire de ma vie n’existe pas. Ça n’existe pas. Il n’y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l’on fait croire qu’il y avait quelqu’un, ce n’est pas vrai il n’y avait personne. L’histoire d’une toute petite partie de ma jeunesse je l’ai plus ou moins écrite déjà, enfin je veux dire, de quoi l’apercevoir, je parle de celle-ci justement, de celle de la traversée du fleuve. Ce que je fais ici est différent, et pareil. Avant, j’ai parlé des périodes claires, de celles qui étaient éclairées. Ici je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements.
J’ai commencé à écrire dans un milieu qui me portait très fort à la pudeur. Écrire pour eux était encore moral. Écrire, maintenant, il semblerait que ce ne soit plus rien bien souvent. Quelquefois je sais cela que du moment que ce n’est pas, toutes choses confondues, aller à la vanité et au vent, écrire ce n’est rien. Que du moment que ce n’est pas, chaque fois, toutes choses confondues en une seule par essence inqualifiable, écrire ce n’est rien que publicité. Mais le plus souvent je n’ai pas d’avis, je vois que tous les champs sont ouverts, qu’il n’y aurait plus de murs, que l’écrit ne saurait plus où se mettre pour se cacher, se faire, se lire, que son inconvenance fondamentale ne serait plus respectée, mais je n’y pense pas plus avant […].
C’est au cours de ce voyage que l’image se serait détachée, qu’elle aurait été enlevée à la somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu être prise, comme une autre, ailleurs, dans d’autres circonstances. Mais elle ne l’a pas été. L’objet était trop mince pour la provoquer. Qui aurait pu penser à ça ? Elle n’aurait pu être prise que si on avait pu préjuger de l’importance de cet événement dans ma vie, cette traversée du fleuve. Or, tandis que celle– ci s’opérait, on ignorait encore jusqu’à son existence. Dieu seul la connaissait. C’est pourquoi, cette image, et il ne pouvait pas en être autrement, elle n’existe pas. Elle a été omise. Elle a été oubliée. Elle n’a pas été détachée, enlevée à la somme. C’est à ce manque d’avoir été faite qu’elle doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d’en être justement l’auteur. C’est donc pendant la traversée d’un bras du Mékong sur le bac qui est entre Vinhlong et Sadec dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, celle des Oiseaux. Je descends du car. Je vais au bastingage.
Je regarde le fleuve
Ma mère me dit quelquefois que jamais, de ma vie entière, je ne reverrai des fleuves aussi beaux que ceux-là, aussi grands, aussi sauvages, le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans, ces territoires d’eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans. Dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite, ils versent comme si la terre penchait. Je descends toujours du car quand on arrive sur le bac, la nuit aussi, parce que toujours j’ai peur, j’ai peur que les câbles cèdent, que nous soyons emportés vers la mer. Dans le courant terrible je regarde le dernier moment de ma vie. Le courant est si fort, il emporterait tout, aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville.
Il y a une tempête qui souffle à l’intérieur des eaux du fleuve. Du vent qui se débat. Je porte une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente. Avant, elle a été une robe de ma mère, un jour elle ne l’a plus mise parce qu’elle la trouvait trop claire, elle me l’a donnée. Cette robe est sans manches, très décolletée. Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l’usage. C’est une robe dont je me souviens. Je trouve qu’elle me va bien. J’ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Je ne me souviens pas des chaussures que je portais ces années-là mais seulement de certaines robes. La plupart du temps je suis pieds nus en sandales de toile. Je parle du temps qui a précédé le collège de Saigon. À partir de là bien sûr j’ai toujours mis des chaussures. Ce jour-là je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. […]
Quand je suis sur le bac du Mékong, ce jour de la limousine noire, la concession du barrage n’a pas encore été abandonnée par ma mère. De temps en temps on fait encore la route, comme avant, la nuit, on y va encore tous les trois, on va y passer quelques jours. On reste là sur la véranda du bungalow, face à la montagne du Siam. Et puis on repart. Elle n’a rien à y faire mais elle y revient. Mon petit frère et moi on est près d’elle sur la véranda face à la forêt. On est trop grands maintenant, on ne se baigne plus dans le rac, on ne va plus chasser la panthère noire dans les marécages des embouchures, on ne va plus ni dans la forêt ni dans les villages des poivrières.
Tout a grandi autour de nous
Il n’y a plus d’enfants ni sur les buffles ni ailleurs. On est atteints d’étrangeté nous aussi et la même lenteur que celle qui a gagné ma mère nous a gagnés nous aussi. On a appris rien, à regarder la forêt, à attendre, à pleurer. Les terres du bas sont définitivement perdues, les domestiques cultivent les parcelles du haut, on leur laisse le paddy, ils restent là sans salaire, ils profitent des bonnes paillotes que ma mère a fait construire. Ils nous aiment comme si nous étions des membres de leur famille, ils font comme s’ils gardaient le bungalow et ils le gardent. Rien ne manque à la pauvre vaisselle. La toiture pourrie par les pluies continue à disparaître. Mais les meubles sont nettoyés. Et la forme du bungalow est là pure comme un dessin, visible de la route. Les portes sont ouvertes chaque jour pour que le vent passe et sèche le bois. Et fermées le soir aux chiens errants, aux contrebandiers de la montagne. […]
Le vent s’est arrêté et il fait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Des oiseaux crient de toutes leurs forces, des déments, ils s’aiguisent le bec contre l’air froid, ils le font sonner dans toute son étendue de façon presque assourdissante. Les paquebots remontaient la rivière de Saïgon, moteurs arrêtés, tirés par des remorqueurs, jusqu’aux installations portuaires qui se trouvaient dans celle des boucles du Mékong qui est à la hauteur de Saïgon. Cette boucle, ce bras du Mékong, s’appelle la Rivière, la Rivière de Saigon. L’escale était de huit jours. Du moment que les bateaux étaient à quai, la France était là. On pouvait aller dîner en France, y danser, c’était trop cher pour ma mère et de plus pour elle ce n’était pas la peine, mais avec lui, l’amant de Cholen, on aurait pu y aller. Il n’y allait pas parce qu’il aurait eu peur d’être vu avec la petite blanche si jeune, il ne le disait pas mais elle le savait. À cette époque– là, et ce n’est pas encore si loin, à peine cinquante ans, il n’y avait que les bateaux pour aller partout dans le monde.
De grandes fractions des continents étaient encore sans routes, sans chemins de fer. Sur des centaines, des milliers de kilomètres carrés il n’y avait encore que les chemins de la préhistoire. C’était les beaux paquebots des Messageries Maritimes, les mousquetaires de la ligne, le Porthos, le D’Artagnan, l’Aramis, qui reliaient l’Indochine à la France. Ce voyage-là durait vingt-quatre jours. Les paquebots des lignes étaient déjà des villes avec des rues, des bars, des cafés, des bibliothèques, des salons, des rencontres, des amants, des mariages, des morts. Des sociétés de hasard se formaient, elles étaient obligées, on le savait, on ne l’oubliait pas, et de ce fait elles devenaient vivables, et même parfois inoubliables d’agrément. C’était là les seuls voyages des femmes. Pour beaucoup d’entre elles surtout mais pour certains hommes parfois, les voyages pour se rendre à la colonie restaient la véritable aventure de l’entreprise. Pour la mère ils avaient toujours été, avec notre petite enfance, ce qu’elle appelait « le meilleur de sa vie ».[…]
Les départs
C’était toujours les mêmes départs. C’était toujours les premiers départs sur les mers. La séparation d’avec la terre s’était toujours faite dans la douleur et le même désespoir, mais ça n’avait jamais empêché les hommes de partir, les juifs, les hommes de la pensée et les purs voyageurs du seul voyage sur la mer, et ça n’avait jamais empêché non plus les femmes de les laisser aller, elles qui ne partaient jamais, qui restaient garder le lieu natal, la race, les biens, la raison d’être du retour. Pendant des siècles les navires avaient fait que les voyages étaient plus lents, plus tragiques aussi qu’ils ne le sont de nos jours. La durée du voyage couvrait la longueur de la distance de façon naturelle. On était habitué à ces lentes vitesses humaines sur la terre et sur la mer, à ces retards, à ces attentes du vent, des éclaircies, des naufrages, du soleil, de la mort. Les paquebots qu’avait connus la petite blanche étaient déjà parmi les derniers courriers du monde. C’était pendant sa jeunesse en effet que les premières lignes d’avion avaient été instituées qui devaient progressivement priver l’humanité des voyages à travers les mers. […]
Il y avait la mer de Chine, la mer Rouge, l’océan Indien, le canal de Suez, le matin on se réveillait et c’était fait, on le savait à l’absence de trépidations, on avançait dans les sables. Mais avant tout il y avait cet océan. C’était le plus loin, le plus vaste, il touchait le pôle Sud, le plus long entre les escales, entre Ceylan et la Somalie. Certaines fois il était si calme et le temps si pur, si doux, qu’il s’agissait, quand on le traversait, comme d’un autre voyage que celui à travers la mer. Alors tout le bateau s’ouvrait, les salons, les coursives, les hublots. Les passagers fuyaient leurs cabines torrides et dormaient à même le pont. […]
Et une autre fois, c’était encore au cours de ce même voyage, pendant la traversée de ce même océan, la nuit de même était déjà commencée, il s’est produit dans le grand salon du pont principal l’éclatement d’une valse de Chopin qu’elle connaissait de façon secrète et intime parce qu’elle avait essayé de l’apprendre pendant des mois et qu’elle n’était jamais arrivée à la jouer correctement, jamais, ce qui avait fait qu’ensuite sa mère avait consenti à lui faire abandonner le piano.
Cette nuit-là, perdue entre les nuits et les nuits, de cela elle était sûre, la jeune fille l’avait justement passée sur ce bateau et elle avait été là quand cette chose– là s’était produite, cet éclatement de la musique de Chopin sous le ciel illuminé de brillances. Il n’y avait pas un souffle de vent et la musique s’était répandue partout dans le paquebot noir, comme une injonction du ciel dont on ne savait pas à quoi elle avait trait, comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur. Et la jeune fille s’était dressée comme pour aller à son tour se tuer, se jeter à son tour dans la mer et après elle avait pleuré parce qu’elle avait pensé à cet homme de Cholen et elle n’avait pas été sûre tout à coup de ne pas l’avoir aimé d’un amour qu’elle n’avait pas vu parce qu’il s’était perdu dans l’histoire comme l’eau dans le sable et qu’elle le retrouvait seulement maintenant à cet instant de la musique jetée à travers la mer. […]
L’Amant de Marguerite Duras et les autres épisodes du podcast Ça fait du bien par Kristine Maerel, chaque semaine sur Radio-Châteaubriant.
Musiques : (CC BY-SA 2.0) Lemon and Melon et Chopin (Valse n°2 en la mineur).