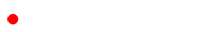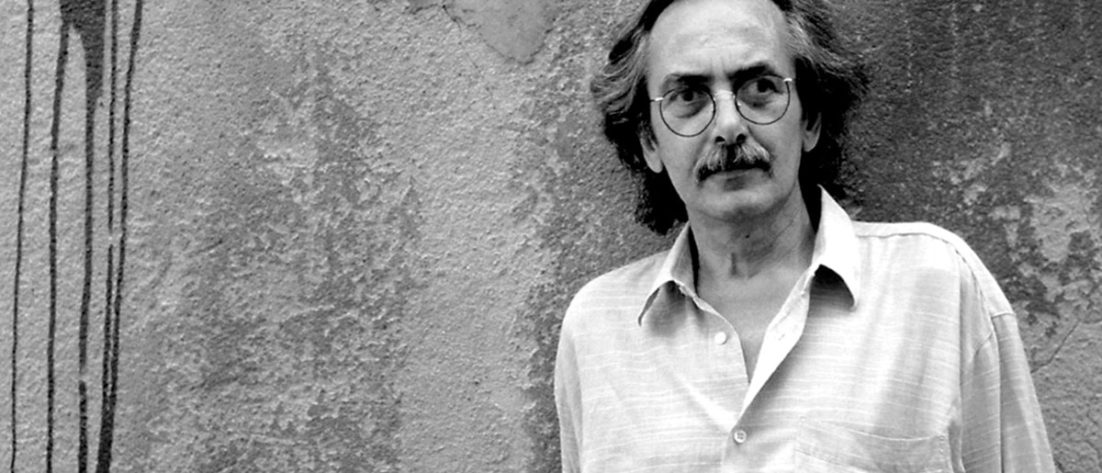Les Marins Perdus de Jean-Claude Izzo, le récit du cargo l’Aldébaran, bloqué au large de Marseille, avec son équipage à bord. L’auteur de la trilogie Total Kheops, Chourmo et Soléa, y raconte sa ville, de la Joliette à l’Estaque, et la souffrance des marins. Ces voyageurs au long cours, mariés à la mer, affrontent les tempêtes et ne supportent pas cette terre qui ne tangue plus assez sous leurs pieds.
Les Marins Perdus
Jean-Claude Izzo
Extraits
Marseille, ce matin-là, avait des couleurs de mer du Nord. Diamantis avala, vite fait, un Nescafé dans la salle commune déserte, puis il descendit sur le pont, en sifflotant Besame Mucho, l’air qui lui venait le plus souvent à l’esprit. Le seul qu’il sut siffler aussi. Il sortit une Camel d’un paquet froissé, l’alluma et s’appuyant au bastingage. Diamantis, ça ne le gênait pas, ce temps, pas ce jour-là, en tout cas. Depuis le réveil, il avait le moral poissé dans la grisaille.
Il laissa son regard errer sur la mer, vers le large, pour tenter de repousser ce moment où, comme chacun des marins de l’Aldébaran, il lui faudrait prendre une décision. Décider, ce n’était pas son fort. Depuis vingt-cinq ans, il se laissait porter par la vie. D’un cargo à un autre. D’un port à un autre.
Le ciel virait à l’orage, et, au loin, les îles du Frioul n’étaient plus qu’une tâche sombre. C’est à peine si l’on distingue l’horizon. Une vraie journée sans avenir, pensa Diamantis. Sans oser se dire que cette journée ressemblait aux précédentes. Cinq mois qu’ils étaient là, les marins de l’Aldébaran. À quai, relégué au bout des six kilomètres de la digue du large. Loin de tout. Sans rien dire. Et sans fric. À attendre un hypothétique repreneur de ce foutu cargo.
L’Aldébaran était arrivé à Marseille le 22 janvier. De la Spezia, en Italie. Pour charger deux mille tonnes de farine à destination de la Mauritanie. Tout allait bien. Trois heures après, le tribunal de commerce avait bloqué le navire, en garantie des dettes contractées par leur armateur. Constantin Takis, un Chypriote. Depuis, plus personne n’avait eu de nouvelles de lui. « Un sacré fils de pute », avait simplement dit Abdoul Aziz, le capitaine de l’Aldébaran. Puis d’un geste dégoûté, il avait tendu la décision de justice à Diamantis, son second.
Dans le Journal du jour, la haine, elle s’étalait sur toutes les pages.
En Bosnie, au Rwanda, en Tchétchénie, en Irlande. Diamantis avait envie de reprendre la mer. S’éloigner. S’oublier dans une nuit d’étoiles en plein océan. Se dissoudre entre ciel et mer. Il y avait peu de chances que cela se produise rapidement. Il s’était renseigné à la mission des gens de mer. À Marseille, rare étaient les navires ou l’on pouvait embaucher. Il lui fallait revenir à son point de départ. À la Spezia. Ou partir ailleurs.
Ça péta sur la mer d’abord. Puis sur la ville ensuite. Un orage violent. Comme il en éclate seulement deux ou trois fois l’an. Chaque fois que l’horizon s’embrasait d’éclairs bleus et verts, le château d’If et les îles du Frioul surgissaient de la nuit. Le tonnerre suivait quelques minutes après. Non pas un roulement tel qu’on a l’habitude d’entendre, mais un claquement à tout rompre. Sec, froid. Métallique.
L’Aldébaran se mit à tanguer. Sa coque semblait prête à se tordre. La pluie suivit. D’énormes gouttes dures. Presque de la grêle. On aurait dit que le cargo essuyait un peu de mitraille. Au premier coup de tonnerre, Diamantis avait fait un bond sur sa couchette. Il avait eu du mal à trouver le sommeil. À cause de la chaleur. Sa cabine – si on pouvait appeler comme ça sont réduit – était une étuve. Il s’était mis à poil sur son couchage, mais même ainsi il ruisselait de sueur et quand il ne dormait pas, il pensait. Ou plutôt, les pensées les plus diverses assaillaient son esprit, tournaient en rond dans sa tête. Pour devenir des idées noires. Souvent, depuis qu’ils étaient coincés ici, il se réveillait même la nuit. Aujourd’hui, l’orage s’en était chargé.
De son hublot, il assistait maintenant au spectacle
Sa cabine, à bâbord, faisait face au large. Il s’imagina en haute mer. Non pas à bord de l’Aldébaran, mais sur un autre navire. Le Maris Stella, un gros caboteur. Sa route était la route de la navigation classique en Méditerranée. On chargeait et déchargeait à chaque port. Diamantis avait remplacé au pied levé Michaelis, un vieil ami dont la femme allait accoucher. « Je peux pas t’en empêcher d’être marin, elle avait dit avant qu’ils ne se marient. Mais si tu veux que je te fasse un enfant, arrête de partir si longtemps. » Michaelis n’avait pas hésité. Il venait d’avoir cinquante ans. Angela avait vingt ans de moins que lui, et elle était vraiment très jolie. Avec le Maris Stella, Michaelis pouvait être chez lui tous les quinze jours.
Cette nuit-là, en fin janvier, le Maris Stella venait de quitter Limassol, à Chypre, pour Beyrouth. Il s’attendait à un gros grain. Ils eurent pire. Une tempête comme la Méditerranée en réserve parfois. Contrairement à ce que l’on croit, cette mer n’est pas une mer tranquille. Elle est, par excellence, une mer à coups de tabac.
Le Maris Stella avait trente-cinq ans d’âge à la proue et à la poupe, six de moins au milieu. Il avait été élargi afin de recevoir de plus grosses cargaisons. Vers 11h, les vents soufflaient en rafales à cent dix kilomètre-heure et la crête des vagues monta à huit mètres de haut. Le navire labourait la mer tant qu’il pouvait. Mais l’eau se mit à entrer par les écoutilles avant comme dans une passoire. Une heure plus tard, la mer commença a submergé la poupe alourdie, et le navire donna de la bande.
Koumi, le capitaine- parrain désigné de l’enfant de Michaelis et Angela- demanda à Diamantis :
– Tu connais une bonne prière ?
Il secoua la tête.
– Les prières, tu sais…
– Alors, dis aux radios d’appeler les garde-côtes. On va abandonner le Maris Stella.
C’était un ordre. Il n’était pas à discuter. Koumi connaissait parfaitement son navire, la Méditerranée et les tempêtes. Et il aime la vie. Ils n’eurent jamais le temps de mettre le canot de sauvetage à la mer. Le bateau chavira, les importants dans l’eau glacée.
Au lever du jour, le Maris Stella gisait à vingt-cinq mètres de profondeur
Emportés par ce que les garde-côtes appellent « l’effet dynamique d’une mer démontée ». On eut beau poursuivre les recherches jusqu’à ce que la nuit retombe, Diamantis fut le seul survivant.
Depuis, Diamantis était le parrain d’une mignonne petite fille de cinq ans, Anastasia. Et il avait la trouille des tempêtes.
Il enfila un caleçon, alluma une clope et alla dans la salle commune pour se servir une bière.
Abdoul le rejoignit.
– Impossible de dormir, grommela-t-il.
– Bière ? Lui demanda Diamantis en lui tendant une canette.
Il lui raconta le drame du Maris Stella.
Ils se turent et burent en silence un long moment. La pluie continuait de marteler le pont. De temps en temps, le tonnerre craquait, toujours aussi violent. L’orage les unissait. Comme en mer la tempête soude l’équipage. Aucun marin ne raconte jamais à sa famille ces moments-là. Ni par lettre, ni de retour à la maison. Pour ne pas inquiéter. Parce que c’est inracontable aussi. Les tempêtes n’existent pas. Pas plus que les marins, une fois en mer. La seule réalité humaine des hommes, c’est la terre. D’ailleurs, on ne connaît, et on ne connaîtra, de marin qu’à terre. À moins de s’embarquer un jour à bord d’un cargo.
Diamantis se souvenait que, quelques mois après le naufrage du Maris Stella, alors qu’il regardait les informations à la télé, un commentaire lui avait fait dresser l’oreille. On voyait des images des dégâts causés par les intempéries en Angleterre. Il y avait eu six morts. « Mais, avait rassuré le journaliste, tout danger était écarté la tempête a quitté les côtes pour aller se perdre au large. »
« Au large » de toutes les côtes, des milliers d’hommes n’avaient aucune existence. Même pour les femmes de marin. Leur mari n’avait de réalité qu’à son retour.
La lumière écrasait la ville. Une lumière crue, presque cruelle
Elle repoussait vers les rues sombres et fraîches, les avenues, les places ombragées et les terrasses des cafés. C’était l’heure où l’on tirait les persiennes pour sauver un peu de fraîcheur. Abdoul Aziz avait marché jusqu’ à ce moment-là.
Il avait marché des heures. Comme si, de marcher, sans but, pouvait l’aider à vider sa tête de toutes les pensées, confuses, contradictoires, qui s’y débattaient. Marcher lui faisait un bien fou. Cela ne lui était plus arrivé depuis trop longtemps. Ça tiraillait dans ses mollets, dans son ventre aussi, et jusque dans ses épaules. Il aurait pu être heureux, comme n’importe qui se laissant aller à traîner dans Marseille, s’il n’y avait eu, en lui, tant de tristesse, de rancœur, d’inquiétude, de colère. Il s’était retrouvé devant l’entrée du jardin du Pharo. Il sourit. On pouvait traverser cette ville en tous sens, jamais on ne s’y perdait.
Il grimpa une des allées en haut de la butte, il contourna l’ancien palais de l’impératrice Joséphine. Il ignorait à quoi servait aujourd’hui le bâtiment. À dire vrai, il s’en foutait. Il était venu là pour la vue qu’on y avait sur le port, sur la ville. Elle était sublime.
Il redescendit de quelques mètres, puis il s’assit dans l’herbe, à l’ombre d’un massif de lauriers. Il se laissa envahir par la chaleur parfumée de l’air.
Devant lui, le fort Saint-Jean, ancienne commanderie des hospitaliers de Jérusalem. La lumière semblait vouloir se régaler du rose de ses pierres. Elle en léchait les moindres aspérités avec autant de passion, de plaisir, qu’une glace à la framboise.
En contrebas, l’étroit goulet, autrefois stratégique, par lequel on accède au Vieux-Port. À peine franchi, des voiliers prenaient leur envol vers la rade. Des yeux, il suivait l’une des navettes, qui revenait, vide, des îles du Frioul et du château d’If.
Elle irait s’amarrer sur le quai, devant la Canebière qu’il devinait à peine
Son regard se déplaça légèrement, à gauche du fort Saint-Jean, sur la cathédrale de la Major, faussement byzantine, pompeuse, grise et lourde, cernée d’axes routiers aussi invraisemblables que laids. Derrière elle, le port de la Joliette s’étendait jusqu’à l’Estaque. Ses grues et ses portiques semblaient s’agripper au ciel. Pas grand-chose n’y bougeait. Comme si la chaleur avait banni tout mouvement. L’air, à cet instant, avait la couleur du Sahara. Son immobilité. Le moindre rêve de voyage, comme l’air, s’épuisait et se perdait dans ses sables.
Loin, tout au bout, oublié au bout des quais, l’Aldébaran, qu’il ne voyait pas, était soumis à cette immobilité. Mais cela n’avait plus d’importance. D’ici tout lui paraissait soudainement futile. Il songea à cela avec paresse, sans même faire l’effort de formuler cette pensée dans son esprit.
D’un pochon, il sortit un sandwich tomates, thon, olives et se mit à manger en prenant garde que l’huile ne dégouline pas sur ses doigts. Tout en mastiquant, il se laissa envahir par le bonheur, simple, incompréhensible, qui descend du ciel sur la mer. Céphée lui donne la main. Ils viennent de se marier. Il marche à travers les ruines de Byblos.
– Si j’ai une histoire tu vois, elle commence là. Dans ces ruines. Quand Byblos redevient Jbaïl.
Il lui raconte Jbaïl. Le petit port méditerranéen des origines phocéennes. L’une des plus anciennes cités du monde.
– Selon une vieille légende, Adonis mourut dans les bras d’Astarté, aux sources du fleuve Nar Ibrahim. Son sang fit naitre les anémones et tinta de rouge la rivière. Les larmes d’Astarté rendirent Adonis à la vie, irriguèrent et fertilisèrent la terre…Ma terre.
Céphée s’est serrée contre lui. Elle lève son visage vers le sien, elle sourit, puis l’embrasse sur la joue.
Il est beau ton pays
Le même bonheur coulait du ciel vers la mer. Il s’était dit alors que c’était ça, la seule gloire du monde. Le droit d’aimer sans mesure. Il avait envie d’étreindre le corps de Céphée, comme il l’avait fait ce jour-là. De l’aimer dans les senteurs de figues et de jasmin.
Les souvenirs, les pensées reprenaient le dessus. Pourquoi ne pas retourner là-bas, à Byblos ? Pour y vivre. Elle et lui, avec les enfants. Le Liban se reconstruisait, comme ne cessait de le lui seriner son frère Walid. Les touristes reviendraient, et le commerce allait renaître des cendres de la guerre. Walid avait de quoi investir. Avec ou sans lui, il investirait. Il tenait sa de son père, le goût pour les affaires.
Il ouvrit une boîte de bière et bu goulument. Pourquoi ne se décidait-il pas ? Qu’avait-il à gagner sur la mer, loin de ceux qu’il aimait ? Quelle malédiction l’avait frappé un jour, lui et tant d’autres, qui ne trouvaient sens à la vie que loin de tout rivage ?
Dans le bassin de la grande Joliette, le Citerna 38 engagea sa manœuvre. Lentement, il longea la digue Sainte-Marie. Il pivota et il se mit face au large. Un mouvement sublime, qui rendit au port, puis à la ville, ses gestes et ses couleurs. Son brouhaha. Sa raison d’être. Toutes les questions de Abdoul Aziz se dissipèrent. Il se leva.
Quelques mètres plus haut, assis sur un banc de pierre, il croisa deux amoureux étroitement enlacés. Les yeux rivés sur le cargo. Derrière eux, l’immense sculpture aux héros victimes de la mer. Deux hommes. L’un soutenu par l’autre, celui-ci le bras tendu vers le large. Abdoul Aziz pensa furtivement à Diamantis et à lui, puis, au passage, il adressa un sourire aux deux amoureux. Ils ne prêtèrent pas attention à lui. Leur regard était tendu vers l’horizon. Là ou meurent les rêves, et naissent les larmes.
Les Marins Perdus de Jean-Claude Izzo et les autres épisodes du podcast Ça fait du bien par Kristine Maerel, chaque semaine sur Radio-Châteaubriant.
Musiques : (CC BY-SA 2.0) Lemon and Melon et Aldo Romano/Louis Sclavis/Henri Texier (Annobon).
Photo Jean-Claude Izzo © Jean-Marie Huron